Le Tertiaire : l’âge d’or des mammifères.
Le tertiaire (de 65 à 2 millions d’années)commence juste apres la crise K/T qui met fin au reigne de dinosaure, avec seulement un quart des espèces survivantes.les mers débarrassés des grands reptiles aquatiques, sont toujours occupées par les poissons, qui survivent en compagnie de nombreux céphalopodes : pieuvres, calamars, sèches et nautiles, accompagnés de moules, d’huîtres et d’autre bivalves.
Sur la terre ferme, les mammifères, relégués à des rôles secondaires par les grands dinosaures, les remplacent progressivement. Parmi eux, les mésonychidés ont une morphologie adaptée à leur environnement. Ils sont maître des rivages.
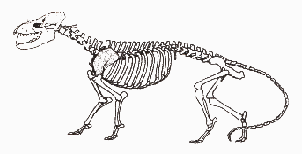
| Squelette et dessin de mésonychidé. Il y a 60 millions d'années, le Mesonyx possédait toutes les caractéristiques d'un mammifère terrestre. Repoussé par des prédateurs mieux armés, il survécut en s'adaptant à la vie dans les océans. Ses lointains descendants s'appellent baleines et dauphins. |
L'évolution des mésonychidés en cétacés pourrait en quelque sorte être assimilée au repli stratégique d'une branche animale décidée à survivre face à des prédateurs mieux armés. Ainsi le mode de vie du Mésonyx, dont la forme générale rappelle celle d'un chien de grande taille au museau allongé, peut-il être comparé à celui des loutre actuelles. Progressivement, les différentes parties du corps s'adaptent à un mode de vie aquatique : adaptation à la nage des membres antérieurs, régression des membres postérieurs (vestigiels chez certains cétacés actuel), modification de la queue, qui s'aplatit et devient le principal moyen de propulsion. Le recul progressif des narines vers le sommet du crâne permet de respirer tout en conservant la possibilité de voir sous la surface de l'eau.
L'Eocène : le grand bond en avant. Il y a 55 millions d'années, assistons à une modification spectaculaire et « rapide de la morphologie de ces archéocète (ancêtre des cétacés). Certains fossiles attestent de ces mutation : le Pakicetus, dont le crâne, découvert au Pakistan, révèle le présence d'une bulle tympanique, est bien la preuve d'une adaptation de l'ouïe à la vie marine.
| Ambulocetus natan. Il y a 52 millions d'années, cet animal long de 2 à 3 mètres, queue comprise, vivait à proximité des rivages. Sa morphologie, son poids (300 kg) son mode de vie le rendent comparable à l'actuelle loutre géante du Venezuela (Otaria byronia) |
| Basilosaurus (-45 à -38 millions d'années) |
Vers le Dauphins d’aujourd’hui
Il y a 40 millions d’années apparaissent plusieurs types d’archéocétes évolués, dont les darudontidés. Ces derniers préfigurent les dauphins modernes quant à la silhouette et à la taille (environ 5m). Lorsque la Terre s’ouvre de nouveau. L’Antarctique s’écarte de l’Amérique du Sud, modifiant l’influence des courants, d’où un abaissement progressif de la température des océans, cause probable de la disparition des archéocètes. Les derniers d’entre eux, le Kekeodon, familier des côtes de Nouvelle-Zélande, disparaît il y a 30 millions d’années. Il y a 35 millions d'années, les agorophiidés, véritables ancêtres des cétacés à dents (odontocètes), sont déjà en place. Leurs grands choix biologique sont déjà faits. Prédateurs perfectionnés, leur bouche est armée de dents ; ils naviguent et chassent grâce à l'écholocation (voir« les sens »), qui se substitue avantageusement à la vue en eau trouble et agitée, souvent encombrée d'obstacles. Les derniers représentants s'éteignent il y a 20 millions d'années, laissant la place aux squalodontidés.
Le Quaternaire : aujourd'hui. A partir du début du Pléistocène, il y a 2 millions d'années, alors que les brusques changement de climat bouleversent la flore et la faune terrestre, les espèces purement marine n'évoluent plus que de manière secondaire. A peu de chose près, les baleines et les dauphins tels qu'ils sont de nos jours sillonnaient déjà les mers de l'époque. C'est donc sur la terre ferme que se produit l'événement le plus considérable. Un singe, l'australopithèque, commence à fabriquer des outils rudimentaires. L'Homo habilis est né. Rien ne sera jamais comme avant.